Le 25 centimes du président Bonaparte
[Extrait des Confections — dont on peut lire l'introduction ici]


«Le véritable lieu de naissance, écrit Marguerite Yourcenar dans les Mémoires d’Hadrien, est celui où l’on a porté pour la première fois un coup d’œil intelligent sur soi-même: mes premières patries ont été des livres». Je dirais volontiers: pour moi aussi, mais j’ajouterais que ce furent également les timbres.
e,
Je fus en effet, tôt à l’adolescence — mais il ne me quitta jamais complètement par la suite —, hanté par le démon de la philatélie. Cette activité, aujourd’hui tombée dans la plus ringarde des désuétudes, fut pourtant, pendant des décennies, le hobby de milliards de piaffants adolescents, tout en étant le noble passe-temps de bien des rois.
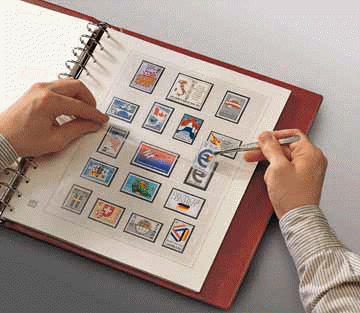

Je compris vite que les timbres étaient une prodigieuse métaphore du monde, une extraordinaire clé pour y entrer, le découvrir et l’explorer. Chaque pays ayant en effet ses timbres, chaque timbre provenait donc d’un pays dont je pouvais apprendre le nom, la capitale, l’unité monétaire, la ou les langues qu’on y parlait, la ou les religions qu’on y pratiquait — ou qu’on y interdisait, comme dans le cas des pays «communistes» —, le système politique qui s’y déployait, les révolutions qui, le cas échéant, l’avaient bousculé, l’histoire qui s’y était déroulée, la culture qui, sous toutes ses formes, s’y était épanouie. À vrai dire, les seuls aspects à propos desquels les timbres avaient tendance à conserver un rigide mutisme, c’étaient les velléités sécessionnistes — dont on savait parfois qu’elles compliquaient la vie de telle république et gênaient celle de tel royaume. Ça n’a pas tellement changé depuis: ce n’est pas sur les timbres que l’on peut compter pour nous apprendre grand chose des aspirations indépendantistes de la Catalogne, de l’Écosse, du Khalistan, de l’Oromia, de la Kabylie, de l’Eelam Tamoul, ou — si tant est que de telles aspirations y existent encore — du Québec.







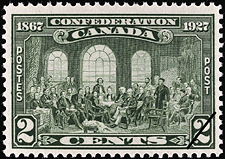
Des siècles avant Google et Wikipedia, muni d’une petite encyclopédie en deux tomes — et en anglais — reçue pour quelque anniversaire, j’étais Rastignac à l’assaut de l’univers.


Ces petites vignettes, à partir du moment où elles cessèrent de représenter uniquement les souverains de profil ou les Mariannes qui en tenaient lieu dans les républiques,



devenaient les œuvres d’un extraordinaire musée imaginaire de tous les trésors du monde;
les pyramides égyptiennes y côtoyaient les totems haïda, les primitifs flamands partageaient leur page d’album avec avec des poteries aztèques, des tapisseries médiévales narguaient des spoutniks soviétiques,






des masques subsahariens faisaient des clins d’œil à des bouddhas impassibles,




les musiciens y avaient leurs dates de naissance, on voyait même parfois les partitions de leurs œuvres, qu’on eût pu siffloter si on eût connu le solfège;


Hamlet contemplait le crâne de Yorik, on entendait presque le tambour des guerriers sur un 30 centimes du Ruanda-Urundi;



la Grèce n’avait évidemment pas manqué de célébrer les traits de Platon et de Socrate, la RDA ceux de Marx, le Vatican ceux de Pie IX;




les postes françaises n’en finissaient plus, pour leur part, de multiplier les châteaux et les cathédrales, les toiles de maîtres et les grands personnages; j’eus le bonheur de trouver le timbre qui commémorait la fondation de l’Abbaye-aux-Hommes, que je reconnus sans peine quand je la visitai, à Caen, quatre décennies plus tard;




je me demandais en revanche s’il fallait lire saint Wandrille ou saint Mandrille dans le gothique tarabiscoté d’une abbaye de 25 F, émise en 1949: ma Viking Desk Encyclopædia était décidément trop petite pour tout savoir. Ce devait être un W, tout compte fait, vu qu’il y avait des mandrilles au zoo de Granby, mais c’était une sorte de babouins, pas de moines...


J’avais vite compris que je pouvais lancer ma curiosité à l’assaut de toutes ces connaissances, que je dispose de 10 000 timbres d’un pays ou que je n’en possède qu’un seul. Que m’aurait en effet donné d’encombrer mes albums de toute la production philatélique de l’Inde ou du Costa-Rica? Un seul timbre m’arrivait et tout était peuplé! Cette passion, si je n’étais pas devenu professeur d’anthropologie religieuse, m’aurait peut-être, qui sait, guidé vers la carrière diplomatique. Mon éducation philatélique m’aurait en tout cas mieux préparé que ce monsignore, nonce apostolique en Éthiopie, croisé à une garden party dans les jardins de l’ambassadeur du Canada à Addis Abeba, en 1972. Voyant la petite feuille d’érable rouge que je portais alors fièrement à la boutonnière, avant l’évolution de mes convictions constitutionnelles, le grave ambassadeur du Saint-Siège m’apostrophe dans un français aux accents délicieusement toscans: «Ah mais jé vois qué vous êtes Irlandais!


